L’Institut du monde arabe à Paris poursuit son excellent programme intitulé « Ce que la Palestine apporte au monde », un ensemble de manifestations embrassant toutes les disciplines: j’avais ainsi assisté au formidable concert du trio Joubran – que j’ai chroniqué ici même -, ainsi qu’à une projection sur grand écran du film d’Elia Suleiman It must be heaven, dont la puissance et l’étrangeté n’ont pas pris une ride.
Dans ce cadre, Sadia Agsous (chercheure en littérature, cultures et traductologie, enseignante en études culturelles Moyen-Orient et Afrique du Nord) était interrogée hier après-midi – 10/06/2023 – par Judith Abensour (réalisatrice et enseignante à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs – dernier film: Foedora), à propos de son nouveau livre Derrière l’hébreu, l’arabe
(Classiques Garnier, 2022).
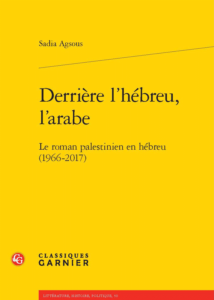
Ce très beau titre recouvre un sujet peu abordé, celui de ces quelques écrivains palestiniens restés en Israël qui, à travers les décennies, ont choisi d’écrire en hébreu – soit, comme l’a fort justement formulé Judith Abensour dans une de ses questions à Sadia Agsous, dans la langue même de ceux qui cherchent à les effacer…
Le livre a beau être écrit par une universitaire rigoureuse et bénéficier à ce titre d’une recherche impeccable, il est avant tout l’œuvre d’une passionnée.
Peut-être parce que, de son propre aveu, ce sujet de la cohabitation de deux langues « antagonistes » (mais les langues ne s’opposent pas naturellement, ce sont leurs locuteurs qui ont une propension à s’affronter et à oppresser leurs semblables) la concerne personnellement.
Cela tient – selon les réponses qu’elle a livrées à son intervieweuse – à un ensemble de raisons, parmi lesquelles son identité algérienne (la cohabitation des langues, les Algériens en savent quelque chose, dans un pays où se côtoient quotidiennement le kabyle, l’arabe et le français), son mari juif ashkénaze (hélas parti trop tôt, il a laissé la prise de conscience après coup que le « judéo-arabe » était ancré dans leur famille), enfin son intuition de ce que la Nakba palestinienne, et plus encore la défaite arabe de 1967, a structuré l’ensemble de la région (intuition qui l’a poussée à apprendre l’hébreu jusqu’à le maîtriser parfaitement).
Alors c’était décidé, la Palestine serait au coeur de sa thèse; après quelques tâtonnements (un premier projet, axé sur un parallèle entre la politique d’Israël et le régime de l’Apartheid s’est heurté au déni des institutions) a surgi cette idée de travailler sur cette littérature palestinienne écrite en hébreu.
L’analyse opérée dans l’ouvrage est axée sur trois auteurs choisis dans des générations différentes: Atallah Mansour (né en 1934, auteur en 1966 de Sous un nouveau jour, premier roman palestinien en hébreu), Anton Shammas (né en 1950, auteur du fameux Arabesques, loué pour sa langue hébraïque somptueuse autant que pour sa construction élaborée) et, plus près de nous, Sayed Qashua (né en 1975, auteur aussi désabusé que désopilant de plusieurs romans en hébreu, dont le plus connu est sans doute Les Arabes dansent aussi).
Ce choix d’écrire en hébreu pose évidemment la question du pourquoi: pour occuper une place dans le champ littéraire, pour s’adresser au public majoritaire, ou plus prosaïquement parce que c’est dans ce milieu hébréophone qu’ils vivaient et devaient gagner leur subsistance…
Mais plus fondamentalement, la vraie question est celle du comment: qu’ont fait ces auteurs arabes palestiniens de l’hébreu, comment se sont-ils glissés dans cette langue – l’hébreu réformé – qui n’avait pas été conçue pour accueillir une parole autre que juive… Et ce qui ressort de l’analyse, justement, c’est qu’ils ont, chacun à leur manière, fait dire à cette langue des choses qu’on n’y disait pas, qu’ils y ont « fait parler » des personnages qui en étaient absents (puisque dans la littérature en hébreu, le Palestinien est soit un fantôme, soit un archétype arriéré ou violent).
Pour décrire ces stratégies, Sadia Agsous se livre à une analyse littéraire éclairée par le contexte sociologique et politique de chaque période, en affirmant la spécificité des réponses apportées par chaque auteur.
Au passage, sont convoquées les grandes figures de la littérature palestinienne comme Émile Habibi (auteur du mythique Peptimiste), Ghassan Kanafani ou Mahmoud Darwich, qui ont tous dû, à un titre ou à autre, frayer avec la question de la langue et de l’altérité.
Bref, vous l’aurez compris, c’est un livre d’une richesse inouïe, rédigé avec rigueur tout en étant accessible à un large public. Pour peu qu’on s’intéresse à cette région du monde, ce livre passionné et passionnant offre un angle original, celui du choix qu’ont fait certains de recourir à la langue de l’autre pour dire leur vérité. Il porte une idée – la cohabitation des langues, et au-delà, de ceux qui les parlent – qui apparaît actuellement utopique, tellement que ces expériences se sont retrouvées sous le feu des acteurs culturels dominants et se sont généralement soldées par l’échec ou le renoncement.
Mais les utopies d’aujourd’hui ne pourraient-elles pas un jour – sait-on jamais – réclamer leur dû?
